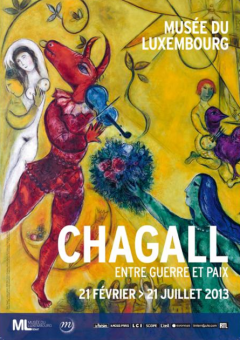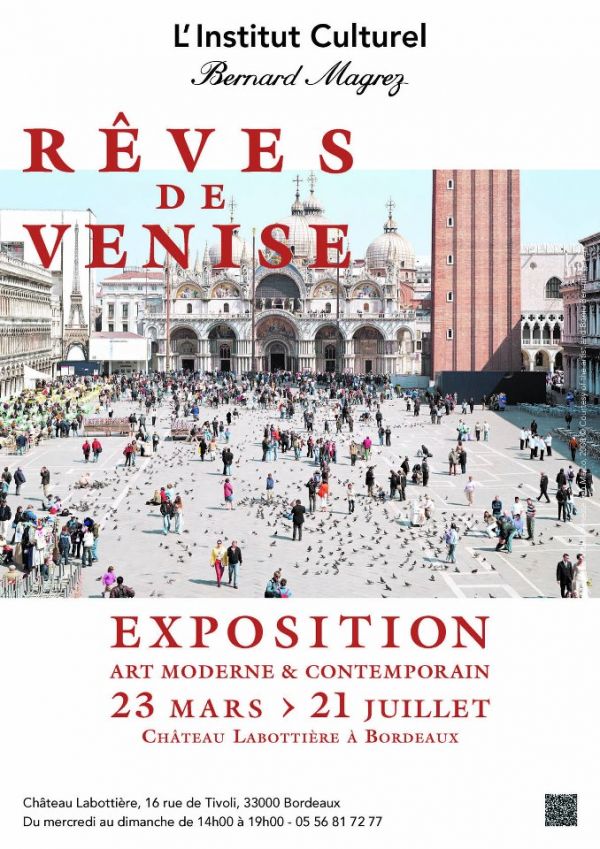L’Abbatiale Saint Pierre de Moissac, entre Montauban et Agen, présente des merveilles de l’art roman.
Le portail sud de l’Abbatiale présente un remarquable tympan, inspiré de la vision du retour du Christ selon l’Apocalypse de Saint Jean. Le christ en majesté est entouré des symboles des quatre évangélistes (l’homme de Matthieu, le taureau de Luc, le lion de Marc et l’aigle de Jean) et des vingt-quatre vieillards. Continuer la lecture de « L’Abbatiale Saint Pierre de Moissac »