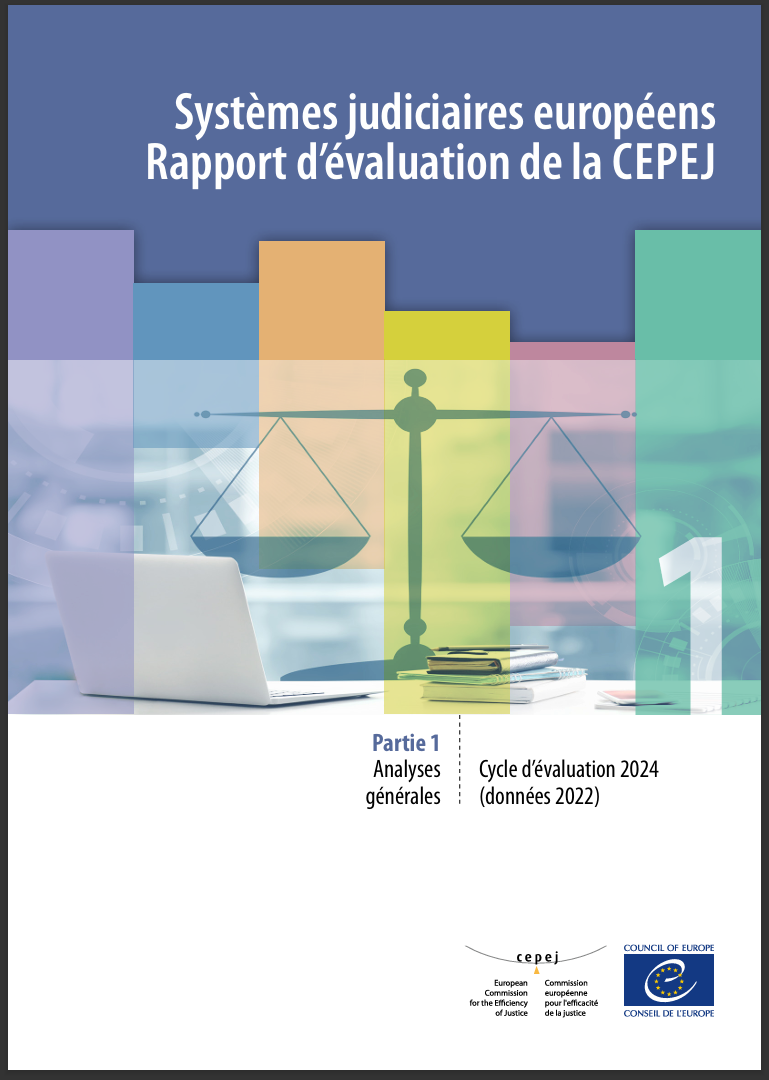La CEPEJ (Commission européenne pour l’efficacité de la justice), une structure du Conseil de l’Europe, a publié en septembre 2024 le rapport d’évaluation des systèmes judiciaires européens, qu’elle réalise tous les deux ans.
La CEPEJ est composée d’experts des 46 membres du Conseil de l’Europe. « Elle propose des mesures et outils concrets pour améliorer l’efficacité et la qualité du service public de la justice au bénéfice de ses usagers », lit-on sur son site Internet. Le rapport publié l’an dernier est fondé sur les chiffres de 2022.
Elle s’intéresse aux systèmes judiciaires au sens strict, c’est-à-dire aux tribunaux, au ministère public et à l’aide judiciaire. Des fonctions exercées dans de nombreux pays par le ministère de la justice, la gestion des prisons et de la probation par exemple, ne sont pas concernées.

La France n’investit pas assez dans son système judiciaire
Nous nous intéressons ici à la position de la France, comparée à celle des autres pays membres du Conseil de l’Europe. S’agissant du budget consacré au système judiciaire, la CEPEJ regroupe les pays en quatre catégories selon leur PIB par habitant. La première constatation est que la France investit moins dans son système judiciaire que les pays comparables : 77,2€ par habitant et 0,20% de son PIB, contre 92,1€ par habitant et 0,30% du PIB en moyenne pour les pays ayant le même niveau de richesse.
Le rapport détaille les sommes allouées aux tribunaux, au ministère public et à l’aide judiciaire. L’écart entre la France et les pays comparables est moins grand s’agissant de l’aide judiciaire : 9,28€ en France, 10,29€ ailleurs.
Le sous-investissement dans la justice impacte le nombre de juges professionnels : 11 en France pour 100 000 habitants, 17,8 en médiane dans les pays membres du Conseil de l’Europe. Le nombre de procureurs est de 2,9 pour 100 000 habitants, la médiane européenne étant de 10,4.
Le rapport comporte des informations intéressantes. Un juge en début de carrière gagnait en 2022 46 812€ par an. La profession est fortement féminisée : 69% des juges sont des femmes. La profession est attrayante, si l’on considère le faible taux de réussite au concours (11% contre une médiane de 20% en Europe). La formation continue des juges est faible : 0,2%e des juges (et 0% des procureurs) ont participé à une session de formation en 2022, alors que la médiane européenne est de 1,9 participations.

Les indicateurs d’efficacité du système judiciaire
Le rapport mesure l’efficacité de la justice par deux indicateurs. Le Clearance Rate (CR) résulte du rapport entre le nombre d’affaires terminées et le nombre d’affaires nouvelles. Plus il est élevé, plus le système est performant. Le Disposition Time (DT) est la durée d’écoulement du stock d’affaires pendantes. Il s’obtient en divisant le nombre d’affaires pendantes à la fin d’une période par le nombre d’affaires terminées pendant la période. Ce nombre est multiplié par 365 pour obtenir un nombre de jours. Plus il est faible, plus le système est performant.
Nous nous intéressons ici au domaine pénal, et non à la justice civile ou commerciale ni à la justice administrative. En 2022, le CR (Clearance rate) était en France de 95%, ce qui signifie un retard de 5% sur le volume d’affaires à traiter. Quant au DT (Disposition Time), il n’a pas été fourni par l’administration française. L’expérience empirique suggère qu’il est particulièrement élevé.
Le rapport de la CEPEJ s’intéresse à l’utilisation des technologies de l’information par les systèmes judiciaires européens. Un indice de déploiement a été calculé. En médiane pour les pays du Conseil de l’Europe, il est de 4,5 en matière civile, 4,1 en matière administrative et 4,1 en matière pénale. La France se caractérise par une forte pénétration de l’informatique en manière administrative (indice 6,6), et beaucoup plus faible en matière civile (1,78) et pénale (2,5).

L’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires
Le rapport contient des réflexions intéressantes sur le développement de l’intelligence artificielle. Il rappelle que « la CEPEJ a adopté en 2018 une “Charte éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement”. La Charte offre un cadre structuré de principes conçus pour aider les décideurs politiques, les législateurs et les professionnels de la justice à naviguer dans l’intégration de l’IA dans les processus judiciaires nationaux. »
Tout en insistant sur les dangers d’une utilisation aveugle de l’IA, le rapport indique les multiples usages que les systèmes judiciaires peuvent en faire.
« L’IA offre de multiples possibilités de révolutionner le paysage juridique. L’analyse prédictive, alimentée par des données historiques, offre des perspectives sur l’issue des affaires, ce qui permet de prendre des décisions équitables et d’optimiser l’affectation des ressources.
« Le traitement du langage naturel (NLP) rationalise les processus juridiques en résumant les documents, en extrayant les informations clés et en améliorant les capacités de recherche juridique.
« Les algorithmes d’apprentissage automatique classent les affaires par ordre de priorité en fonction de leur gravité et de leur impact potentiel, ce qui garantit une affectation efficace des ressources et une résolution rapide des litiges.
« Les salles d’audience virtuelles, rendues possibles par l’IA, améliorent l’accessibilité à la justice grâce aux audiences en ligne et à la transcription en temps réel, ce qui favorise l’inclusivité et l’efficacité.
« La technologie blockchain sécurise la documentation juridique, atténuant le risque de fraude et garantissant l’intégrité des transactions.
« La réalité virtuelle (RV) peut aider à la reconstitution des scènes de crime, en facilitant l’analyse médico-légale et en améliorant la compréhension du jury.
« Les pratiques éthiques de l’IA, y compris les techniques d’atténuation des préjugés, peuvent être utilisées pour accroître la justice et l’équité dans les procédures judiciaires.
« L’IA générative peut être utilisée pour rationaliser la production de documents juridiques et alimenter les chatbots juridiques, améliorant ainsi l’accès à l’information juridique.
« Les grands modèles linguistiques (LLM) peuvent alimenter la recherche juridique, contribuer à l’élaboration de stratégies d’affaires et faciliter les services de traduction et d’interprétation, favorisant ainsi un système judiciaire plus efficace, plus inclusif et plus équitable. »
Le rapport alerte sur « le fait de se concentrer uniquement sur le délai de traitement des affaires en tant que mesure de l’efficacité pourrait faire oublier d’autres aspects importants de la performance judiciaire. Bien que le temps de traitement soit une mesure essentielle, il ne reflète pas la qualité des décisions judiciaires, l’accès à la justice ou l’équité des procédures. Une évaluation complète de la cyberjustice devrait prendre en compte ces impacts plus larges afin de fournir une compréhension plus holistique de ses effets sur le système judiciaire. »