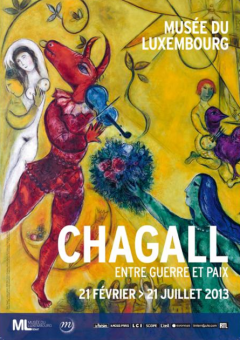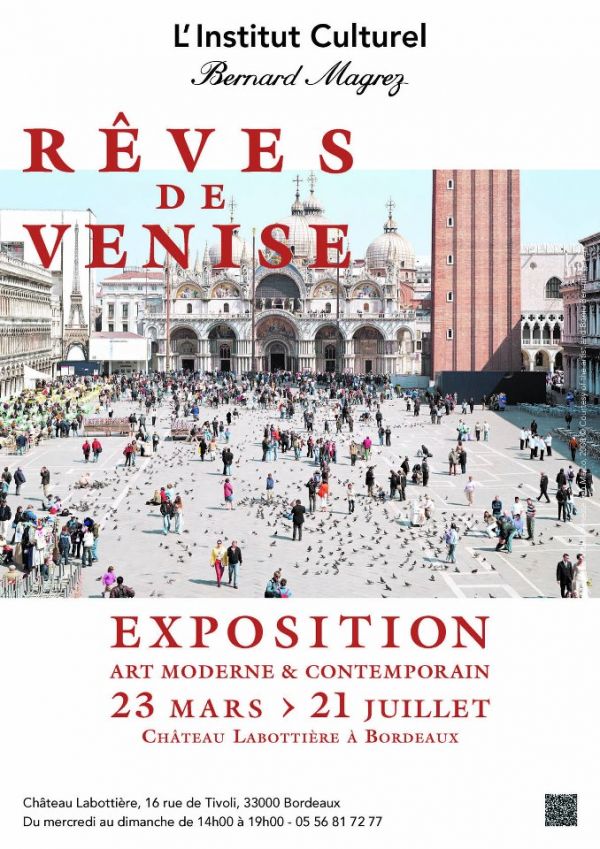Dans sa propriété de Malagar, près de Langon, François Mauriac (1985 – 1970) trouvait un cadre propice à la création littéraire. Il en a fait le cadre de plusieurs de ses romans.
L’association Bordeaux Accueille a organisé une visite du domaine de François Mauriac, donné par ses enfants au conseil régional d’Aquitaine en 1985. Il s’agit d’une grande maison sur la crête d’une colline dont les flancs sont principalement plantés de vigne. Ses façades sont orientées nord – sud. Du côté sud, un jardin et un verger descendent en pente douce vers une terrasse d’où l’on peut admirer un paysage vaste et tranquille et, disent les témoins, voir les Pyrénées lorsque des conditions météorologiques exceptionnelles sont réunies. Continuer la lecture de « Mauriac à Malagar »