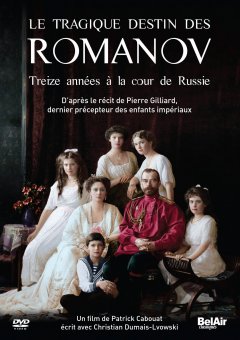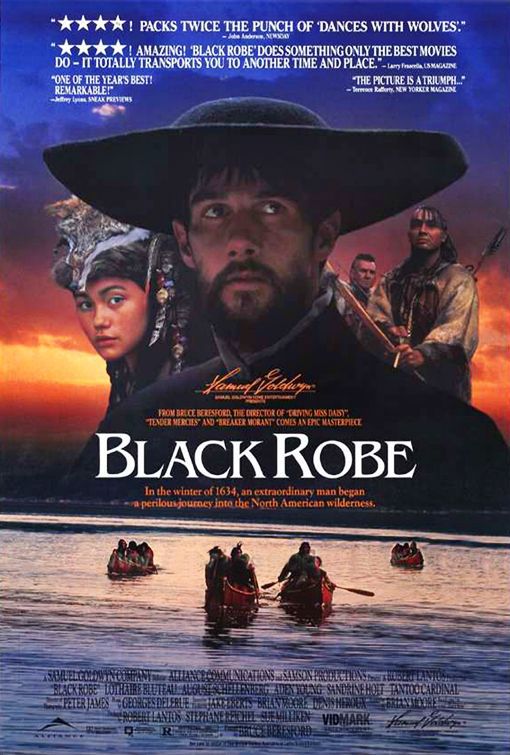La vaccination contre le Covid de Mauricette M dans un hôpital de la Seine Saint-Denis le 27 décembre a été retransmise en direct par les chaînes d’information continue, puis en soirée par les journaux télévisés comme s’il s’agissait d’un acte d’héroïsme.
On a beaucoup et justement critiqué l’impréparation logistique de la campagne de vaccination en France. Or, le diable se loge dans les détails : si les vaccins ne sont pas acheminés en temps et en heure, les plus belles stratégies tournent au fiasco. Continuer la lecture de « Mauricette M, ce héros »