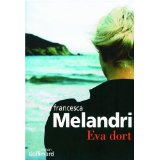Dans le cadre de la semaine nationale des prisons, le groupe local de concertation prison de Bordeaux a organisé le 29 novembre la projection du film « Être là » de Régis Sauder, suivie d’un débat.
« Être là » invite le spectateur à partager la vie du Service médico-psychiatrique de la maison d’arrêt des Baumettes à Marseille. Au sein de la prison a été aménagé un espace avec des bureaux pour les psychiatres et les infirmières, un local d’ergothérapie et, à l’étage supérieur, des cellules pour des détenus psychopathes hospitalisé au sein même de la prison. Continuer la lecture de « Être là »