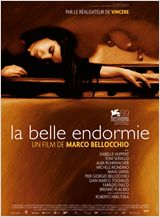Le ministre britannique de la Justice Chris Gayling a annoncé une réforme radicale du système de probation pour les prisonniers ayant accompli une courte peine. Le nombre de prisonniers concernés va être étendu ; de nouvelles mesures coercitives vont être introduites ; le système va être largement privatisé.
« Transhumances » s’est déjà fait l’écho des mesures durcissant le système carcéral en Angleterre et au Pays de Galles (l’Ecosse et l’Irlande du Nord ne sont pas concernées). C’est maintenant à la réhabilitation des prisonniers condamnés à de courtes peines que s’attaque le ministre de la Justice Chris Gayling. Continuer la lecture de « Vers une réforme radicale de la probation en Grande Bretagne »