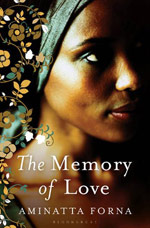« Le Placard », film de Francis Weber (2001), constitue une jolie et drôle parabole sur les chemins de la confiance en soi.
François Pignon (Daniel Auteuil) se vit lui-même comme un raté, un moins-que-rien. Dans la photo d’entreprise annuelle, il est proprement éjecté du cadre ; il apprend d’ailleurs qu’il fait partie d’une prochaine charrette de licenciements. Depuis deux ans, son ex-femme et son fils l’ont eux aussi éjecté de leur vie. Pignon est sauvé du suicide par son nouveau voisin, Belone (Michel Aumont).
Belone propose à Pignon un plan pour sauver son emploi : se faire passer pour gay, faire croire qu’il « sort du placard ». Dans une entreprise qui fabrique des préservatifs, se mettre à dos la communauté homosexuelle représente un risque qu’on ne peut courir. Des photos, truquées, le représentant dans des situations compromettantes, circulent de service en service. François Pignon, l’homme transparent, celui qui n’existait pas au regard des autres, échappe au licenciement. Mieux encore, il devient le point focal de l’entreprise. Il la représentera à la Gay Pride, juché sur un char, coiffé d’un bonnet en forme de préservatif.
Le chef du personnel, Félix Santini (Gérard Depardieu) est sommé de ravaler ses blagues sur les « tantes » et de se faire ami de Pignon : son identité de gros dur machiste se dissout à vive allure au point de le conduire à l’hôpital psychiatrique. En sens inverse, François Pignon découvre qu’il a une vraie personnalité. Il se réconcilie avec son fils. Il dit à son ex-femme ses quatre vérités. Il devient l’amant de sa belle chef de service, Mlle Bertrand (Michèle Laroque).
« Le Placard » est une grosse comédie. Il faut se laisser aller à rire à gorge déployée et ne pas y rechercher trop de subtilité. Mais c’est une jolie parabole de la « transhumance » d’un homme entre un état de non-existence aux yeux des autres et des siens propres, à une vie assumée et digne.