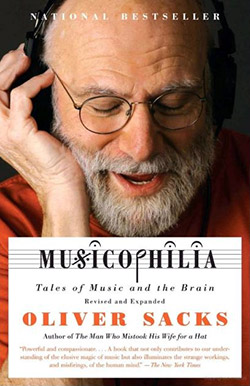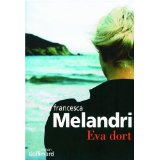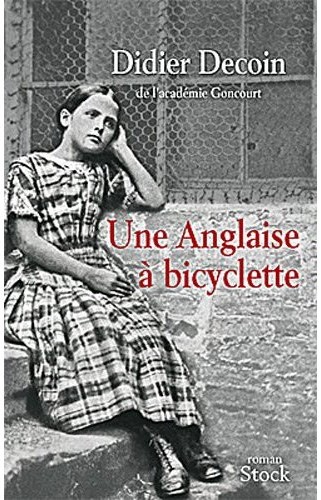Dans Musicophilia, le neurologue Oliver Saks explore, selon de multiples angles d’approche, les relations qui existent entre le cerveau et la musique.
« Transhumances » a récemment publié une note de lecture du livre de Pierre Lemarquis « Sérénade pour un cerveau musicien ». L’ouvrage d’Oliver Saks a un parti-pris davantage scientifique : l’apparat critique (notes et bibliographie) occupe un bon tiers du volume. Mais il fait la part belle à des expériences de patients, y compris les siennes propres en tant que sujet à des hallucinations médicales. Cela donne à son livre une exceptionnelle épaisseur humaine. Il touche aussi à des interrogations philosophiques : que reste-t-il du « soi » lorsqu’une maladie dégénérative du cerveau ôte la mémoire d’événements survenus il y a seulement quelques secondes ? Quelle est la personnalité d’un être que la musique habite de manière obsessionnelle et exclusive ? Continuer la lecture de « Musicophilia »