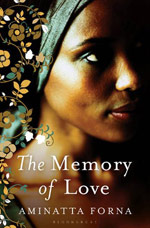Dans « Surfer la vie, comment sur-vivre dans la société fluide » (LLL, Les liens qui libèrent, 2012), Joël de Rosnay se pose la question de comment construire et penser le monde de demain. Passionné de surf, il a choisi ce sport comme fil rouge du livre.
Nous devons apprendre à vivre dans un monde « fluide ». Les repères solides et intemporels tendent à disparaître. Ce qui compte désormais, ce sont les interrelations et interdépendances de multiples phénomènes qui dessinent des configurations sans cesse changeantes. Rien ne sert de s’accrocher à des certitudes ou à des dogmes. Il faut apprendre à juger à chaque instant les forces à l’œuvre et calculer la meilleure trajectoire.
De Rosnay utilise le surf comme métaphore de l’entrée dans l’ère de la fluidité. « Le surfeur tire avantage et plaisir d’un équilibre dynamique entre des flux, dans une fluidité continue du parcours et des mouvements. La vague représente un premier flux, qui roule et se déplace vers la plage (…) Sur la vague, la trajectoire presque parallèle de la planche, que maintient le surfeur pour accroître sa vitesse, représente un deuxième flux. Le troisième, c’est la dynamique de la position du surfeur sur la planche : trop en avant, la planche pique, trop en arrière, il perd la vague. Son adaptation à la glisse de sa planche crée donc une série de mouvements et de positionnements continus qui se matérialisent comme un flux contrôlé dans le temps et dans l’espace ».
Le surf n’est pas seulement un sport. C’est aussi un art de vivre. Joël de Rosnay en évoque deux caractéristiques : une forte composante communautaire, qui se traduit par le fait qu’à tout moment les surfeurs apprennent les uns des autres, qu’ils ont un devoir de secours mutuel et qu’ils évitent de se nuire ; et aussi une approche raisonnée du risque. L’auteur revient à plusieurs reprises sur le « principe d’attrition » opposé au « principe de précaution ». Selon le principe de précaution, on s’interdit d’engager quelque action que ce soit qui puisse supposer un risque ; l’attrition au contraire consiste à accepter la possibilité de pertes mais à tout mettre en œuvre pour en limiter l’ampleur. Dans notre société française gavée de discours de peur, réaffirmer que le « risque zéro » n’existe pas et qu’un excès de précaution paralyse est bon à entendre.
Joël de Rosnay applique la métaphore du surf à l’univers numérique : l’expression de « surfer la toile » est déjà entrée dans le vocabulaire courant. Il décrit l’évolution des réseaux sociaux, qui ne se limiteront pas dans l’avenir à la production et à l’échange de biens immatériels, mais incluront la production décentralisée d’objets ou d’énergie. Il plaide pour une « diététique » de l’information : choisir ce que l’on « mange et boit » sur le Web, situer l’information dans son contexte, s’accorder des pauses de déconnexion entre les immersions. Il cite Michel Serres, qui écrit que l’espace métrique, référé par des distances, est peu à peu remplacé par un espace de voisinage : des personnes mues par une même passion sur deux continents différents peuvent se sentir plus « voisines » que des personnes habitant sur le même palier d’immeuble. Il développe le concept de « Web symbiotique », qui décrit la symbiose croissante entre le cerveau et les outils technologiques.
Le dernier chapitre, intitulé « des règles simples pour surfer la vie », est particulièrement intéressant. De Rosnay insiste sur l’altruisme et mentionne les principes du donnant – donnant de Robert Axelrod : « il recommande par exemple de ne pas être jaloux de la réussite de l’autre ; de ne pas être le premier à faire cavalier seul ; de pratiquer la réciprocité dans tous les cas ; de ne pas se montrer trop malin ; d’enseigner aux gens à se soucier les uns des autres ; d’éviter les conflits inutiles en coopérant aussi longtemps que l’autre coopère ; d’éviter de se montrer susceptible si l’autre fait cavalier seul de manière injustifiée ; de faire preuve d’indulgence (de bienveillance) après avoir riposté à une provocation ; d’avoir un comportement transparent pour que l’autre joueur puisse s’adopter à votre mode d’action ; d’enseigner la réciprocité (donner de la valeur à l’altruisme) ; d’améliorer les capacités de reconnaissance (la stratégie et le « profil » de l’autre) ; de savoir reconnaître la coopération et la réciprocité ; enfin de se montrer soucieux des conséquences de ses actes dans le futur. ».
A la suite de Patrick Viveret, il nous invite à « vivre intensément ce voyage de vie consciente dans l’univers qu’est l’humanité ». Et pour cela, à nous désintoxiquer de nos peurs qui conduisent à l’enfermement identitaire ; et à nous désintoxiquer du stress permanent dans l’entreprise en raison de la compétition et de la concurrence, érigées en véritable règle de vie, presque en art de vie.
De Rosnay fait l’éloge de la Franc-maçonnerie, dont les concepts d’amour fraternel, d’assistance bienfaisante et de vérité sont, selon lui, particulièrement pertinents pour ce monde fluide sur lequel il nous invite à surfer la vie.