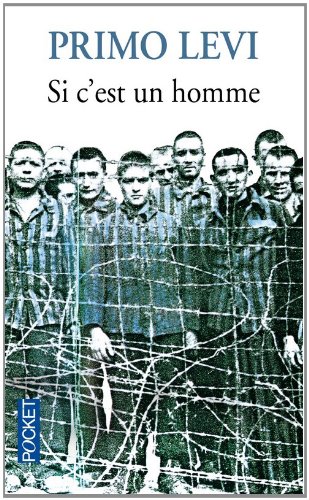Une vie de famille construite sur l’amour mais aussi sur le mensonge peut-elle subsister lorsque la vérité éclate ? Telle est la question posée par le film « d’une vie à l’autre » du réalisateur Georg Maas.
Pendant la guerre, des enfants nés de relations entre des femmes norvégiennes et des soldats de l’armée d’occupation allemande furent arrachés par les Nazis à leur mère et placés dans des orphelinats en Allemagne pour contribuer au renouveau de la race aryenne. Dans les années 1960, la Stasi introduisit en Norvège des orphelins en les faisant passer pour les fils ou les filles de mères à qui leur enfant avait été arraché, dans le but d’espionner les activités militaires norvégiennes. Continuer la lecture de « D’une vie à l’autre »