
Dans Mali ô Mali (Stock, 2014), Erik Orsenna redonne vie à un personnage qu’il avait inventé dix ans plus tôt : Madame Bâ, cette fois transformée en Jeanne d’Arc africaine.
Dans le précédent roman, Madame Bâ, 55 ans, cherchait à obtenir le visa qui lui permettrait de voyager en France et de retrouver l’un de ses petits-fils, Michel, recruté puis recraché par le PSG. Depuis dix ans, Madame Bâ vit à Villiers le Bel, 95400. Elle est devenue une célébrité locale. Mais le moment est venu de revenir au Mali : le Mali, martyrisé par les djihadistes trafiquants, a besoin d’elle !
Madame Bâ emmène avec elle Michel, qu’elle rebaptise Ismaël et qu’elle investit de la fonction de griot, chargé de clamer ses hauts faits. C’est que Madame Bâ ne craint pas la comparaison avec Jeanne d’Arc. Elle se sait investie de deux missions : bouter les fanatiques hors du Mali et convaincre les femmes maliennes de se contenter de deux ou trois enfants, afin d’éviter le chômage de masse et le désespoir qui fabrique les jeunes fanatiques.
La Jeanne d’Arc africaine
Michel / Ismaël est donc le narrateur de l’épopée de sa grand-mère, à Bamako, dans une cour envahie de réfugiés du Nord ; dans un camp de réfugiés à la frontière entre le Niger et le Mali ; au fil de l’eau du Niger, ce fleuve qui monte au nord jusqu’aux confins du Sahara avant de bifurquer de vers l’Océan ; enfin, à Tombouctou, ville régie par la charia mais où elle prétend rouvrir une école et enseigner le contrôle des naissances.
Madame Bâ a un égo surdimensionné et a le don de se rendre insupportable, et redoutable. Cent fois, elle menace Ismaël de le destituer de sa fonction de griot, « un poste de nature quasi-divine, quoiqu’intérimaire ». Même s’il lui arrive de connaître la fatigue et la peur, elle impressionne par sa vigueur et sa témérité. Elle est douée d’une oreille extraordinairement fine, qui lui permet d’entendre des mouvements de troupe à des centaines de kilomètres et de fournir aux Renseignements français des informations qui permettront le succès de l’opération militaire au Nord-Mali.
Les épouses de présidents
Madame Bâ a la dent dure, contre l’armée malienne qui n’a aucune vocation à défendre le pays et encore moins à attaquer, qui compte plus d’officiers que d’hommes de troupe et qui n’est qu’un fromage à se partager entre privilégiés. Elle remarque que « rien n’est plus bavard que la montre » d’un nouveau riche ; « la montre renseigne sur le revenu… le coût de la montre est une marque de gratitude adressée au temps. Le milliardaire remercie le temps de s’être arrêté pour lui ». Elle dénonce une plaie de l’Afrique, « pire que les criquets, pire que le paludisme et le sida mêlés, pire que toutes les désertifications : les épouses. Pas de président sans épouse de président (…). Et pas d’épouses, une ou plusieurs, de présidents africains sans détournements de fonds publics, recel et complicité de recel, trafic d’influence, chaque mois aller – retour en première à Paris, destination avenue Montaigne, pour raison d’Etat, le shopping (…)
Le livre d’Erik Orsenna est rempli de passages inspirés. J’aime celui-ci où Ismaël parle du regard commun à tous les réfugiés. « Un regard qui ne se voit pas, aux couleurs délavées, un regard usé peut-être par trop de sable, peut-être par trop de soleil brûlant, peut-être par trop de scènes de mort, un regard qui ne fait plus confiance au monde, un regard qu’on croit encore regard parce que les yeux sont ouverts mais, derrière, un rideau de fer est tombé, un regard qui ne redevient regard qu’en se posant sur les enfants et encore, pas toujours, il y a des femmes qui regardent les enfants sans les voir, un pâle, très pâle sourire leur vient quand ils jouent. Et c’est tout ». Dans « si c’est un homme », Primo Levi avait parlé de l’extinction du regard des déportés…
Tout le monde oublie les pieds
Un commerçant ambulant qui a installé son étal dans le camp apostrophe Ismaël : « ta patronne, on dit qu’elle s’intéresse aux regards. Et les pieds ? Elle a tort de mépriser les pieds. Tout le monde oublie les pieds. Surtout en ville. Où ce sont les voitures, les mobylettes, les autobus qui transportent. Alors les pieds s’endorment. Ils ne servent plus à rien, ils ne racontent plus rien. Ici, en brousse, c’est une autre affaire, surtout par temps de guerre. Moi, je ne sais pas lire les livres, mais donne-moi un pied, n’importe lequel, tu vas entendre ce que je peux tirer de lui. »
« Mali ô mon Mali » souffre selon moi de deux défauts. La finesse surhumaine de l’ouïe de Madame Bâ relève d’un style épique digne de la Chanson de Roland. Mais cette incursion dans la légende et l’onirique détonne dans un roman dont la principale qualité est la fidèle description de personnes et de groupes humains dans leur contexte social particulier. Le second défaut est un certain manichéisme. Les djihadistes sont présentés comme des truands purs et simples camouflant leurs trafics sous une idéologie bornée et cruelle. L’armée française est saluée comme une libératrice mettant fin à une période d’obscurantisme. S’agissant de l’Afrique, un continent où tout est dans la nuance, on pouvait s’attendre à ce que le drame du Mali – ô Mali ! – soit présenté dans toute sa complexité.

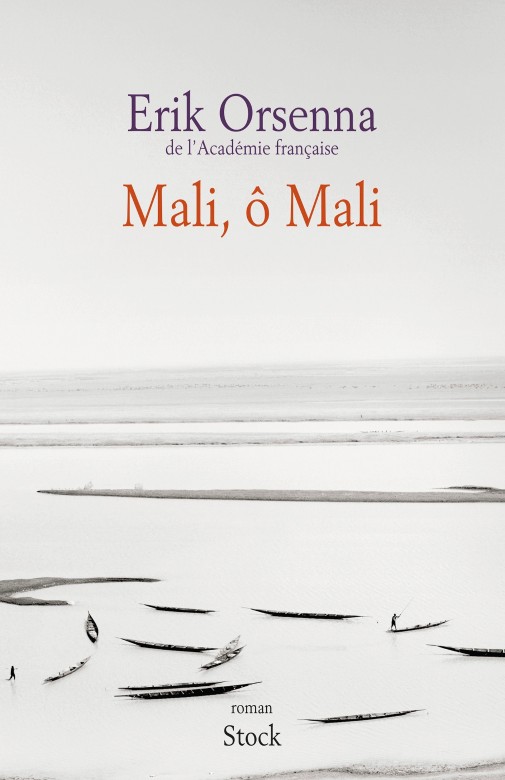
One comment
Pingback: Madame Bâ | Transhumances