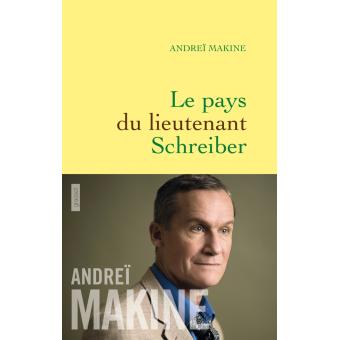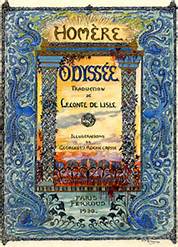Dans « le pays du lieutenant Schreiber, le roman d’une vie », Andreï Makine évoque le mur d’indifférence rencontré par Jean-Claude Servan-Schreiber à ce qu’il vécut pendant la seconde guerre mondiale.
Cette indifférence, Jean-Claude Servan-Schreiber l’a une première fois ressentie dans l’immédiat après-guerre. Né en 1918, celui que ses supérieurs qualifiaient de « gosse souriant et sans peur » avait combattu dans l’armée défaite par les Allemands en 1940. Il avait, le même jour d’avril 1941, reçu sa médaille militaire et son avis d’exclusion de l’armée parce que Juif. Il avait résisté à l’occupant avant de s’enfuir en Espagne en 1942 et d’être interné dans un camp de concentration à Miranda del Ebro. Il avait participé à la libération de la France, depuis le débarquement en Provence jusqu’à la Bavière en passant par l’Alsace, à la tête d’une unité de chars. Continuer la lecture de « Le pays du lieutenant Schreiber »